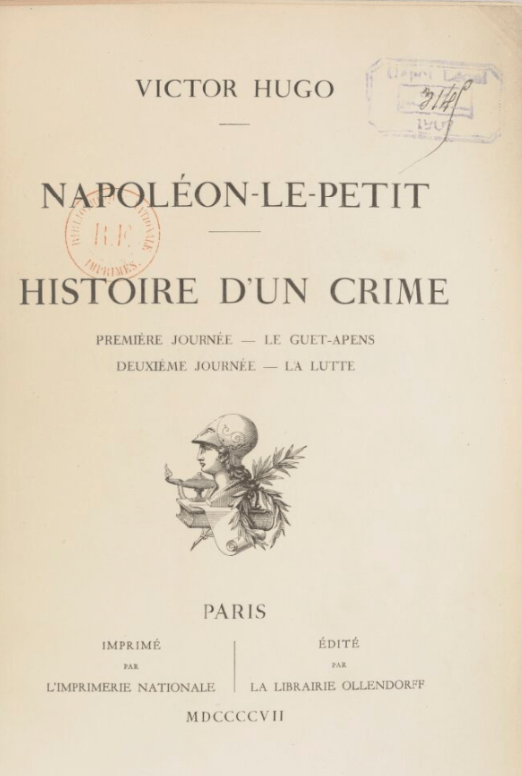Nous en étions aux barricades de juin 1848.
Nous voici trois ans et demi plus tard, lors du coup d’État bonapartiste du 2 décembre 1851. Une des premières choses dont s’est occupé le ministre de la guerre, Saint-Arnaud, c’est la presse. J’ouvre une parenthèse sur ce militaire, un des officiers qui avaient bâti leur gloire et leur carrière dans la « pacification » en Algérie et notamment, dans son cas, en enfumant des familles dans des grottes — la pacification totale, c’est l’assassinat. Les deux héros de juin 1848, Lamoricière et Cavaignac, en avaient d’ailleurs fait autant. Lui, c’est du coup d’état qu’il a été l’artisan. Avant de refermer cette parenthèse, je vous invite à lire la remarquable biographie de ce reître qu’a écrite François Maspero (sous le titre L’honneur de Saint-Arnaud). Tout ça pour dire qu’on ne peut pas faire confiance à la presse, dès le coup d’état. J’utilise donc l’Histoire d’un crime de Victor Hugo comme source.
Une remarque préliminaire : si Victor Hugo dit avoir écrit ce livre à Bruxelles, entre le 14 décembre 1851 et le 5 mai 1852, il n’a été publié qu’en 1877 — on verra que le texte a été enrichi d’informations ultérieures. Il est difficile de couper dans ce texte passionnant, mais comme il est aussi très agréable de le relire, je vais le citer très largement. En vert, Victor Hugo.
À cinq heures, au petit matin du 2 décembre 1851, de tous les points à la fois, l’infanterie sort sans bruit des casernes, les commissaires de police partent saisir chez eux 78 démocrates — redoutés comme possibles chefs de barricades — et arrêter 16 représentants du peuple (députés). Des députés sont emmenés à la prison de Mazas. Victor Hugo est réveillé. Sur les murs il lit les trois placards de Louis-Napoléon Bonaparte, déjà affichés dans les rues. Il se réunit avec d’autres au 70 rue Blanche. Baudin est l’un des « représentants » qui participent à cette réunion. Divers essais d’action, ici ou là dans Paris, on se retrouve à la mairie du 10e (alors au 7 rue de Grenelle, non loin du carrefour de la Croix-Rouge), dont la grande salle était
une espèce de carré long
(plus long que large, je suppose, un rectangle, donc — je ne résiste pas à ce genre de commentaire) pour
y déclarer la déchéance de Louis Bonaparte
mais l’armée évacue les lieux avant que le décret de déchéance soit signé. Le soir, on se retrouve à nouveau au 70 rue Blanche, des journalistes et environ soixante membres de la gauche. Victor Hugo propose une proclamation
— Oui, c’est cela, une proclamation !
— Dictez ! dictez !
— Dictez, me dit Baudin, j’écris.
Je dictai :
Au peuple
Louis-Napoléon Bonaparte est un traître.
Il a violé la Constitution.
Il s’est parjuré.
Il est hors la loi.
On me cria de toutes parts :
— C’est cela ! La mise hors la loi ! Continuez.
Je me remis à dicter ; Baudin écrivait :
Les représentants républicains rappellent au peuple et à l’armée l’article 68…
On m’interrompit : – Citez-le en entier.
— Non, dis-je, ce serait trop long. Il faut quelque chose qu’on puisse placarder sur une carte, coller avec un pain à cacheter et lire en une minute. Je citerai l’article 110 ; il est court et contient l’appel aux armes.
Je repris :
Les représentants républicains rappellent au peuple et à l’armée l’article 68, et l’article 110 ainsi conçu : – « L’Assemblée constituante confie la présente Constitution et les droits qu’elle consacre à la garde et au patriotisme de tous les Français.
Le peuple, désormais et a jamais en possession du suffrage universel, et qui n’a besoin d’aucun prince pour le lui rendre, saura châtier le rebelle.
Que le peuple fasse son devoir. Les représentants républicains marchent à sa tête.
Vive la République ! Aux armes !
On applaudit.
— Signons tous, dit Pelletier.
— Occupons-nous de trouver sur-le-champ une imprimerie, dit Schœlcher, et que la proclamation soit affichée tout de suite.
— Avant la nuit, les jours sont courts, ajouta Joigneaux.
— Tout de suite, tout de suite, plusieurs copies ! cria-t-on.
Baudin, silencieux et rapide, avait déjà fait une deuxième copie de la proclamation.
Un jeune homme, rédacteur d’un journal républicain des départements, sortit de la foule, et déclara que si on lui remettait immédiatement une copie, la proclamation serait avant deux heures placardée à tous les coins de mur de Paris.
Je lui demandai :
— Comment vous nommez-vous ?
Il me répondit :
— Millière.
Millière ; c’est de cette façon que ce nom fit son apparition dans les jours sombres de notre histoire. Je vois encore ce jeune homme pâle, cet œil à la fois perçant et voilé, ce profil doux et sinistre. L’assassinat et le Panthéon l’attendaient ; trop obscur pour entrer dans le temple, assez méritant pour mourir sur le seuil. [Ceci a bien entendu été écrit après la Commune et l’assassinat de Millière au Panthéon.]
Baudin lui montra la copie qu’il venait de faire. Millière s’approcha :
— Vous ne me connaissez pas, dit-il, je m’appelle Millière, mais moi je vous connais, vous êtes Baudin.
Baudin lui tendit la main.
J’ai assisté au serrement de mains de ces deux spectres.
— Je vous avais dit que c’était du Victor Hugo… et ce n’est pas fini.
À suivre, donc
Livres cités
Maspero (François), L’honneur de Saint-Arnaud, Plon (1993).
Hugo (Victor), Histoire d’un crime, C. Lévy (1877).